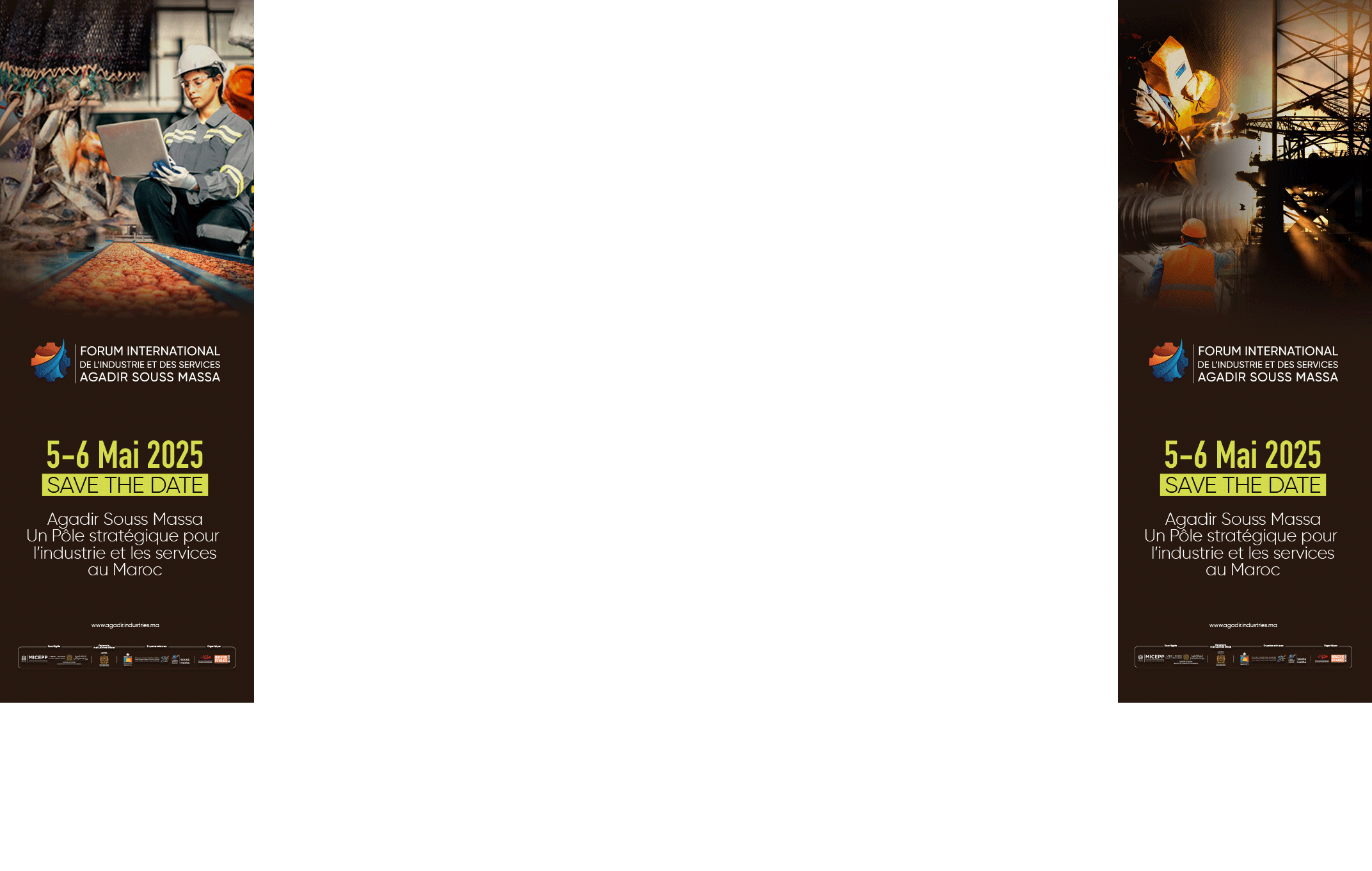Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a relancé une guerre commerciale à grande échelle en instaurant de lourds droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Cette décision s’inscrit dans sa doctrine “America First”, une approche protectionniste visant à redonner aux États-Unis leur souveraineté économique en pénalisant les importations jugées néfastes pour l’industrie nationale. Mais cette stratégie, loin d’être sans conséquences, pourrait bien plonger l’économie américaine dans une spirale inflationniste et exacerber les tensions diplomatiques avec ses principaux partenaires commerciaux.
En signant un décret présidentiel le 3 février, Donald Trump a concrétisé ses menaces. Désormais, les importations en provenance du Canada et du Mexique sont taxées à hauteur de 25 %, tandis que celles de Chine subissent une augmentation supplémentaire de 10 % des tarifs déjà en place. Le président américain justifie ces mesures par la nécessité de protéger l’industrie nationale, de réduire le déficit commercial et de lutter contre l’immigration illégale ainsi que le trafic de fentanyl, un opioïde qui ravage les États-Unis.
Assumant pleinement les conséquences de sa décision, il a déclaré sur son réseau Truth Social que cette politique risquait de provoquer des difficultés économiques à court terme. “Est-ce que cela va faire souffrir ? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l’Amérique et cela vaudra le prix qu’il faudra payer”, a-t-il écrit en lettres capitales.
L’Union européenne et le Royaume-Uni, jusqu’alors épargnés, ne sont pas non plus à l’abri. Trump les accuse d’avoir “dépassé les bornes” en creusant leur déficit commercial avec les États-Unis. Il menace d’instaurer des barrières tarifaires si des concessions ne sont pas rapidement obtenues.
Les réactions immédiates : entre contestations et menaces de représailles
L’annonce a provoqué une levée de boucliers de la part des partenaires commerciaux de Washington. Le Canada a immédiatement dénoncé une “violation des engagements” commerciaux des États-Unis et a annoncé qu’il saisirait l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans la foulée, Ottawa a publié une liste de plus de 1 200 produits américains qui seront taxés dès l’entrée en vigueur des mesures de rétorsion. Cosmétiques, pneus, outillage, électroménager, mais aussi café, vin et produits laitiers sont directement visés, pour un total de 30 milliards de dollars canadiens.
Le Mexique, lui aussi touché, prépare une riposte similaire, qui ciblera notamment les exportations américaines de produits agricoles et industriels. Une nouvelle offensive qui pourrait affecter de nombreux producteurs américains déjà fragilisés par la première guerre commerciale menée par Trump lors de son premier mandat.
La Chine, bien qu’habituée aux affrontements commerciaux avec les États-Unis, a réagi avec prudence, se disant prête à “évaluer la situation avant de prendre les contre-mesures nécessaires”. Pékin pourrait toutefois frapper où cela fait mal en s’attaquant aux exportations de produits agricoles américains et aux semi-conducteurs, deux secteurs où les États-Unis restent vulnérables.
En Europe, la Commission européenne a fermement condamné cette offensive protectionniste, la qualifiant de “nocive pour toutes les parties”. Tout en prônant le dialogue, Bruxelles a prévenu qu’une riposte ferme serait envisagée si les produits européens étaient touchés par ces nouvelles sanctions commerciales.
Quels risques pour l’économie américaine ?
Si Trump défend bec et ongles sa politique en affirmant qu’elle permettra aux États-Unis de mieux négocier leurs accords commerciaux, celle-ci comporte de nombreux risques susceptibles de peser lourdement sur l’économie américaine dans les mois à venir. Le premier danger réside dans la hausse des prix.
En taxant les importations, les entreprises américaines qui dépendent de fournisseurs étrangers verront leurs coûts de production augmenter. Conséquence inévitable : une inflation qui risque de pénaliser les ménages. L’électronique, l’automobile et les biens de consommation courante sont particulièrement concernés. Les prix de nombreux produits importés vont mécaniquement grimper, alors même que les États-Unis peinent encore à maîtriser les effets de la crise inflationniste des dernières années.
L’autre risque majeur concerne les représailles commerciales. Le Canada, le Mexique et la Chine, en augmentant leurs propres taxes sur les produits américains, pourraient provoquer une chute des exportations américaines. Les agriculteurs du Midwest, qui avaient déjà souffert sous la présidence Trump lors des premières sanctions commerciales contre la Chine, pourraient de nouveau faire face à des difficultés liées à des pertes de débouchés.
En ciblant des produits emblématiques comme le soja, le maïs ou les équipements industriels, Pékin et Ottawa pourraient plonger certains États américains dans une crise économique sévère.
L’impact sur la diplomatie est également un facteur clé. En s’attaquant à ses alliés commerciaux historiques, les États-Unis s’isolent davantage. L’Administration Biden avait mis en place une politique de coopération renforcée avec le Canada, le Mexique et l’Union européenne pour contrebalancer l’influence croissante de la Chine sur l’échiquier économique mondial. La nouvelle approche de Trump vient briser cette dynamique et risque d’inciter ces pays à resserrer leurs liens entre eux, reléguant progressivement les États-Unis au second plan.
Enfin, l’incertitude économique et commerciale pourrait peser sur les marchés financiers. Les entreprises américaines, notamment celles dont les chaînes d’approvisionnement sont mondialisées, doivent désormais composer avec des coûts accrus et des tensions géopolitiques croissantes. Les investisseurs, redoutant un ralentissement économique, pourraient adopter une posture prudente, entraînant une plus grande volatilité sur les marchés boursiers.
Jusqu’où ira Donald Trump ?
Le président américain semble convaincu que cette politique de confrontation lui permettra d’obtenir des concessions de la part de ses partenaires commerciaux. Il espère rééditer le succès qu’il revendique avec la renégociation de l’ALENA, qui avait abouti à l’accord ACEUM (Accord Canada–États-Unis–Mexique) lors de son premier mandat.
Mais la situation aujourd’hui est bien différente. Ses partenaires ne semblent pas disposés à céder et affichent une volonté farouche de riposter. Contrairement à 2018, le Canada et le Mexique ont renforcé leurs liens économiques et disposent désormais de nouveaux partenaires commerciaux, notamment en Asie. L’Union européenne, quant à elle, n’entend pas laisser les États-Unis dicter leurs conditions sans contrepartie.
Le pari de Trump repose sur une hypothèse incertaine : que la pression économique contraigne ses adversaires à plier. Mais si cette stratégie se retourne contre l’économie américaine en provoquant une inflation galopante et une chute des exportations, l’opinion publique pourrait vite se retourner contre lui.
Les mois à venir seront déterminants. Si les tensions s’aggravent, l’administration Trump devra choisir entre poursuivre cette escalade protectionniste au risque d’une crise économique ou négocier des accords plus souples pour calmer le jeu. Dans un pays encore divisé et marqué par les turbulences économiques des dernières années, ce choix pourrait être décisif pour la suite de son mandat.
En s’engageant dans cette nouvelle bataille commerciale, Donald Trump joue gros. Sa politique protectionniste pourrait, en théorie, renforcer l’industrie américaine à long terme. Mais à court terme, elle expose les États-Unis à des représailles qui risquent de coûter cher, tant économiquement que diplomatiquement. Ce qui est sûr, c’est que le bras de fer ne fait que commencer.
Désiré Beiblo